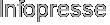Article original publié dans Cent Papiers le 24 janvier 2008
On ne réchauffera pas ce rude hiver avec une pièce élisabéthaine, mais il se joue au TNM une pièce en costumes à saveur sexuelle!
Elizabeth, roi d’Angleterre est l’une des dernières œuvres de l’auteur ontarien Timothy Findley, disparu en 2002. Il s’agit d’un amalgame inattendu mais très cohérent entre un drame classique et un questionnement sur l’identité sexuelle, sur fond d’intrigue politico-sentimentale. Autant le dire tout de suite, cette longue scène sans entracte est tout sauf un lieu où l’on s’exhibe. Elle prend place en Angleterre, pendant une longue nuit de 1601, alors que le Mardi Gras se transforme en Mercredi des Cendres, dans une grange à la fois fastueuse et dépouillée.
Ultime représentante de la dynastie des Tudor, Elizabeth I (Marie-Thérèse Fortin) est dans les derniers milles de son long règne : elle mourra deux ans plus tard en «reine vierge», sans laisser de descendance. Pour se donner quelques repères historiques et mesurer l’humanité du personnage, on précisera qu’elle est la fille du roi Henri VIII – qui exécuta sa mère -, qu’elle a fait décapiter Mary Stuart, sa cousine catholique, et qu’on lui connu quelques amants mais aucun mari. Celle qui avait coutume de faire référence à elle-même comme à un «Prince d’Europe» a pourtant conduit l’Angleterre vers l’un des essors les plus marquants de son histoire.
Face à cette figure autoritaire, un William Shakespeare (Jean-François Casabonne, sans panache) dans une phase de création toujours foisonnante, mais assombrie par la dégénérescence monarchique, de même que par la mort de son fils, puis celle de son père. Plongé dans l’écriture de plusieurs pièces – dont l’emblématique Hamlet – le grand Will puise dans les amours contrariées d’Elizabeth et du comte d’Essex la matière première de son Antoine et Cléopâtre. C’est du moins la proposition de l’auteur.
Mais Shakespeare est pratiquement réduit à l’état de témoin, car c’est un de ses comédiens qui révélera le trouble qui habite l’âme de la reine. Il est bon de préciser que, dans la tradition du théâtre élisabéthain, les hommes jouent tous les rôles, même féminins. Le personnage de Ned Lowenscroft (René Richard Cyr), acteur qui incarne des femmes, confrontera donc Elizabeth, monarque qui s’incarne en homme.
La vraie surprise de cette pièce de facture plutôt classique, c’est de découvrir derrière une Angleterre réputée puritaine un monde où règne l’ambiguïté sexuelle. Des acteurs en robes et en faux-culs, des libertins sans tabous, une souveraine en quête d’émois, le tout sous la menace de la syphilis, métaphore de l’éternelle maladie d’amour.
René Richard Cyr, qui avait réalisé la télésérie Cover Girl, trouve ici une surprenante redéfinition de la drag queen ! Il n’en tire pas moins un plaisir évident à se mettre en scène dans le rôle d’un acteur à l’androgynie assumée et aux attirances troubles.
Inutile pourtant de chercher le frisson polisson : Elizabeth est une pièce sérieuse et tourmentée, une œuvre tellement axée sur le texte que l’action en est presque absente. Pour contrebalancer cette austérité littéraire, les costumes virevoltent, les visages se poudrent et les éclairages flamboient dans le style typique du Nouveau Monde. Mais si par malchance vos sièges sont loin de la scène, il vous faudra quand même faire preuve d’une certaine concentration pour entrer dans le jeu. Enfin, pourquoi doit-il y avoir en permanence tant de personnages sur le plateau, alors que ne se débattent que des causes intimes?
La figure glaciale de la souveraine émerge avec d’autant plus de force que Marie-Thérèse Fortin lui insuffle une autorité précise, palpable. Il était temps que cette comédienne de talent prenne le devant de la scène à Montréal, et il est surprenant que cela ne se produise pas au Théâtre d’Aujourd’hui, dont elle est à la fois codirectrice et directrice artistique. Caprice de reine?