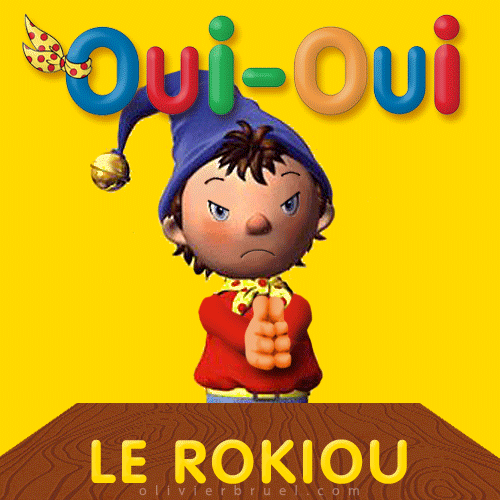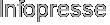Voici le texte que j’ai lu au Cabaret des auteurs du dimanche dont le thème était ANNÉE.
* * *
Une année, c’est quelque chose dans lequel on est tous. Dans le sens qu’on parle tous d’année ce soir, mais on est À L’INTÉRIEUR d’une année. On n’en sort pas. Alors pour prendre un peu de recul par rapport à ça, il existe plusieurs méthodes : l’alcool, la drogue, le déni, la poésie, la méditation, la science. Ce soir, j’ai choisi la science parce que toutes les autres pistes sont déjà couvertes par mes camarades. Les faits que je vais énoncer sont donc vrais. Ce n’est pas vraiment de la littérature, mais j’ai le droit, OK?
Scientifiquement, le temps c’est la 4e dimension. La plupart des experts pensent que le temps a été créé au même moment que le reste de l’univers. Il n’y avait donc pas de temps avant. En fait, le mot «avant» n’a même pas de sens ici.
En 1969, quand l’équipage d’Apollo 11 a posé le pied sur la Lune, ils étaient plus près sur l’échelle du temps de la fin de l’empire ottoman – dissout en 1923 – que de nous, en 2016.
À l’époque des premiers dinosaures, l’année comptait 370 jours. En fait, l’année elle-même n’était pas plus longue, mais les jours étaient plus courts, car la rotation de la Terre ralentit graduellement de 1,7 milliseconde par siècle.
Sur la planète Mercure, un jour dure deux ans.
Plus on se déplace vite, plus le temps ralentit. Si on pouvait voler vers l’étoile Sirius et retour à 99% de la vitesse de la lumière, ça nous prendrait quand même deux ans et demi… mais, à notre retour, on trouverait les Terriens vieillis de 17 ans.
13,8 milliards d’années, c’est l’âge de l’univers. Selon les créationnistes, c’est plutôt 3000 ans, mais je ne suis pas ici pour colporter des conneries. Donc, 13,8 milliards d’années. Si on condensait ça à l’échelle d’une seule année, les dinosaures auraient disparu le 29 décembre, l’humain serait apparu le 31 décembre à 23h54, et Christophe Colomb aurait traversé l’Atlantique une seconde avant minuit.
L’objet le plus vieux connu sur Terre est un fragment de cristal zircon trouvé à Jack Hills en Australie. Il a 4,4 milliards d’années, soit seulement 160 millions d’années de moins que la Terre elle-même.
En France, on guillotinait les condamnés à mort jusqu’en septembre 1977, ce qui veut dire que le premier Star Wars est sorti à l’époque de la guillotine.
Le stégosaure -– ça c’est le dino avec des plaques dressées sur le dos – était présent sur Terre il y a 150 millions d’années. Le célèbre Tyranosaure Rex? C’était il y a 65 millions d’années. Vous ne le réalisez peut-être pas mais le T-Rex est donc plus proche de nous que du stégosaure.
Quand les premières pyramides d’Égypte ont été construites, il y avait encore des mammouths laineux sur Terre.
La reine Cléopâtre (-30) est plus proche de nous que de la construction de la Grande Pyramide (-2 560).
Je ne vous apprends rien, tous les animaux n’ont pas la même espérance de vie. L’éphémère (insecte bien nommé) vit entre 1 heure et 1 jour, la mouche vit un mois, la souris 3 ans, la poule 10, le chat 20, le cheval 40, le poisson rouge 49, l’éléphant 70, le Québécois 83, et la tortue géante 150. La Baleine boréale peut vivre plus de 200 ans, ce qui signifie que certaines de celles qui étaient vivantes en 1851, quand Herman Melville a écrit de Moby Dick sont toujours parmi nous.
Le pin Bristlecone, un arbre d’Amérique du Nord, détient le record de longévité des organismes vivants, juste devant Janine Sutto : il peut vive plus de 5000 ans.
Si vous avec plus de 45 ans, vous avez vu la population mondiale doubler.
Les années sont égales en durée, mais pas en qualité musicale. La musique a ses millésimes, comme le vin. Prenons par exemple 1976. C’est cette année-là que sont sortis Songs In The Key Of Life de Stevie Wonder, Hotel California des Eagles, 1 fois 5 de Charlebois-Vigneault-Léveillée-Deschamps-Ferland, L’Heptade d’Harmonium, Desire et Hard Rain de Dylan, A Trick Of The Tail de Genesis, Longue distance de Charlebois, Trompe la mort, le dernier disque de Brassens, Je te donne de Léo Ferré, Get up off That Thing de James Brown, Deep Purple Live, Shaved Fish de Lennon, A Day At The Races de Queen, L’Homme À Tête De Chou de Gainsbourg, The Song Remains The Same de Led Zeppelin, l’album éponyme de Kate & Anna McGarrigle, Rastaman Vibration de Bob Marley, Black Market de Weather Report, Rock And Roll Heart de Lou Reed, et plein, plein d’autres, c’en est hallucinant!
Toutes les deux minutes, nous prenons autant de photos que l’humanité entière ne l’a fait au cours du 19ème siècle.
Seulement 66 années séparent le décollage du premier aéroplane de la conquète de la Lune.
Et si tout ça vous paraît abstrait, sachez que le père de ma mère est un héros de la guerre. La Première Guerre Mondiale.
On est peu de choses, faites attention à vous-autres!