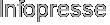Article original publié dans Le Polyscope le 20 mars 2008
Le Théâtre de l’Opsis continue à promener son cycle états-unien de salle en salle, démontrant que la dramaturgie de nos voisins du Sud, loin de se laisser abattre par ces sombres années culturelles, exprime sa vigueur, son mordant et son anticonformisme.
Sarah Ruhl avait tout juste 30 ans quand The Clean House l’a promue au rang d’auteur à succès, lui valant le prestigieux prix Susan Smith Blackburn en 2004 et la hissant en finale du Pulitzer, l’année suivante.
C’est Fanny Britt, une jeune auteure québécoise non moins prometteuse, qui s’est chargée de restituer ces dialogues savoureux dans la langue de Molière. Quoique Molière s’y sentirait sans doute perdu…
Une maison propre n’est donc pas une réclame pour produits ménagers, mais bien une comédie douce-amère qui met en scène un singulier trio de femmes. Voici Mathilda, la jeune Brésilienne qu’on paie pour faire le ménage mais qui préfère inventer des blagues. Puis Lane, sa patronne en déficit d’autorité. Et Virginia, la sœur de Lane, fanatique d’époussetage au point de le faire chez les autres. Viendront s’ajouter deux autres personnages, détonateurs de cette vie pleine de vide : le mari de Lane et sa nouvelle flamme.
En frottant bien, on finit par comprendre qu’il s’agit d’une histoire d’amour. Une histoire étrange mais belle, où un coup de foudre peut soudain dynamiter habitudes et préjugés. En deux actes (presque) sans entracte, naissent et vivent ces personnages très définis, chacun tendu vers un but et bousculé par son interaction avec les autres. Qu’est-ce qu’une femme de ménage qui ne nettoie pas? Qu’est-ce qu’une réussite, si elle n’apporte pas le bonheur? Qu’est-ce que l’amour quand on n’a pas trouvé son âme sœur ? Autant de questions qui nourrissent une réflexion persistante, entre deux bouffées d’humour…
Pour donner corps à ce texte anguleux, il fallait une mise en scène inspirée. Celle de Martin Faucher fait admirablement l’affaire, fourmillant de trouvailles sans jamais y noyer l’intrigue. Ainsi, le réalisme du mobilier de salon se heurte à l’abstraction du plateau où les espaces se délimitent par des lignes au sol, un peu comme dans Dogville. La coulisse ouverte et la liberté que prennent les comédiens avec les limites de la scène appuient le flou qui envahit les personnages. Et tous les costumes se déclinent en noir, à l’exception de deux accessoires dont la vivacité accompagne, comme il se doit, les deux personnages les plus «vivants».
Pour sa première, le 8 février, cette Maison propre n’a souffert d’aucun accroc, aucun défaut de rythme, aucune maladresse… si l’on exclut un bref fou rire qui s’est propagé de la scène au public. L’interprétation est une des forces de ce spectacle, avec mentions spéciales à Émilie Bibeau et Hélène Mercier, chaque attitude et chaque émotion étant exploitées avec précision, dans leur plus grande profondeur.
Car si la vie et la mort sont des blagues, la première doit être parfaite et la seconde fatale.