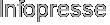Article original publié sur Le Polyscope le 27 octobre 2006

Bonne nouvelle pour le jeune théâtre québécois : une auteure est née, et si elle tient les promesses de Couche avec moi (c’est l’hiver), elle ira loin. Fanny Britt, qui n’a pas 30 ans, a accouché d’un texte mordant, plein de punch-lines et de clins d’œil au spectateur. La recette de base est imparable : des thèmes quotidiens abordés avec assez d’intelligence pour leur donner une portée universelle, une intrigue qui va crescendo, une mise en scène inventive – signée Geoffrey Gaquère -, et une direction d’acteurs tellement affûtée qu’on en oublierait que tout est écrit à l’avance. Comme on n’est pas dans un spectacle de marionnettes, on nous sert une gang d’excellents comédiens, et, ultime bénéfice, tout ceci nous est présenté sur l’un des plus beaux plateaux de théâtre en ville. Imparable, je vous dis.
Couche avec moi (c’est l’hiver) est un «drame urbain» qui met en scène cinq personnages en quête de sens dans l’hiver montréalais. Avec maladresse, ils tentent de rendre leur existence un peu plus conforme à leurs fantasmes existentiels. Selon l’auteure, ils «se divisent en deux grandes catégories d’êtres humains : les déçus (et potentiellement déçus) et les décevants (et potentiellement décevants). Ils sont seuls et assoiffés de contact. Pleins du désir des autres et entièrement étrangers à leurs propres désirs. Ils sont menteurs. Ils sont fatalistes. Ils sont à pleurer. Je les aime comme on s’aime soi-même, c’est-à-dire par pitoyable narcissisme, et avec une formidable envie d’autodestruction». Ça vous dit quelque chose? Vous allez vous sentir beaucoup moins seul!
La pièce propose une vision impitoyable de la génération des 25-35 ans, avec ses envies refoulées, ses rapports aux autres biaisés, sa libido encombrante et pas toujours assumée. Dans ce monde en dérapage, nul n’est désiré par celui qu’il désire, personne n’est satisfait de ce qu’il a. Il y a dans cette histoire autant d’humour que de violence, et les actions des personnages renvoient à des thèmes qui nous concernent tous. Le sexe et le rôle qu’on lui accorde, le culte de la célébrité, le voyeurisme et l’exhibitionnisme, la vanité, le matérialisme, le pouvoir, la manipulation des médias, l’incommunicabilité, la perception de l’autre comme un obstacle, l’hiver qui s’éternise…
Le grand mérite de l’écriture de Fanny Britt est de planter des personnages un peu plus grands que nature sans en faire des clichés ambulants. Il y a Suzanne (Éva Daigle, bouleversante), la future «matante» qui ne veut que ce que les autres veulent. Pierre, son «fiancé» (Stéphan Allard, parfait), archétype du Quebecus Mollus sans envergure. Millie (Ansie St-Martin, glaciale), la sœur de Pierre, retranchée dans son appartement du Plateau. Seul personnage venant d’ailleurs, Gillian (Julie McClemens, très juste), une psychologue britannique dont la présence si loin de chez elle s’expliquera à la fin. Enfin, il y a Marc-André Hébert (Martin Laroche, électrisant), le catalyseur de ce petit monde. Clone charismatique de Patrick Huard, Hébert est un humoriste mégalo dont le dernier projet artistico-médiatique va précipiter l’intrigue en poussant chacun à dévoiler son «animalité»…
Il faudra pelleter profond pour trouver de réels défauts à cette production très maîtrisée, saluée par une ovation méritée… À voir impérativement avant l’hiver!